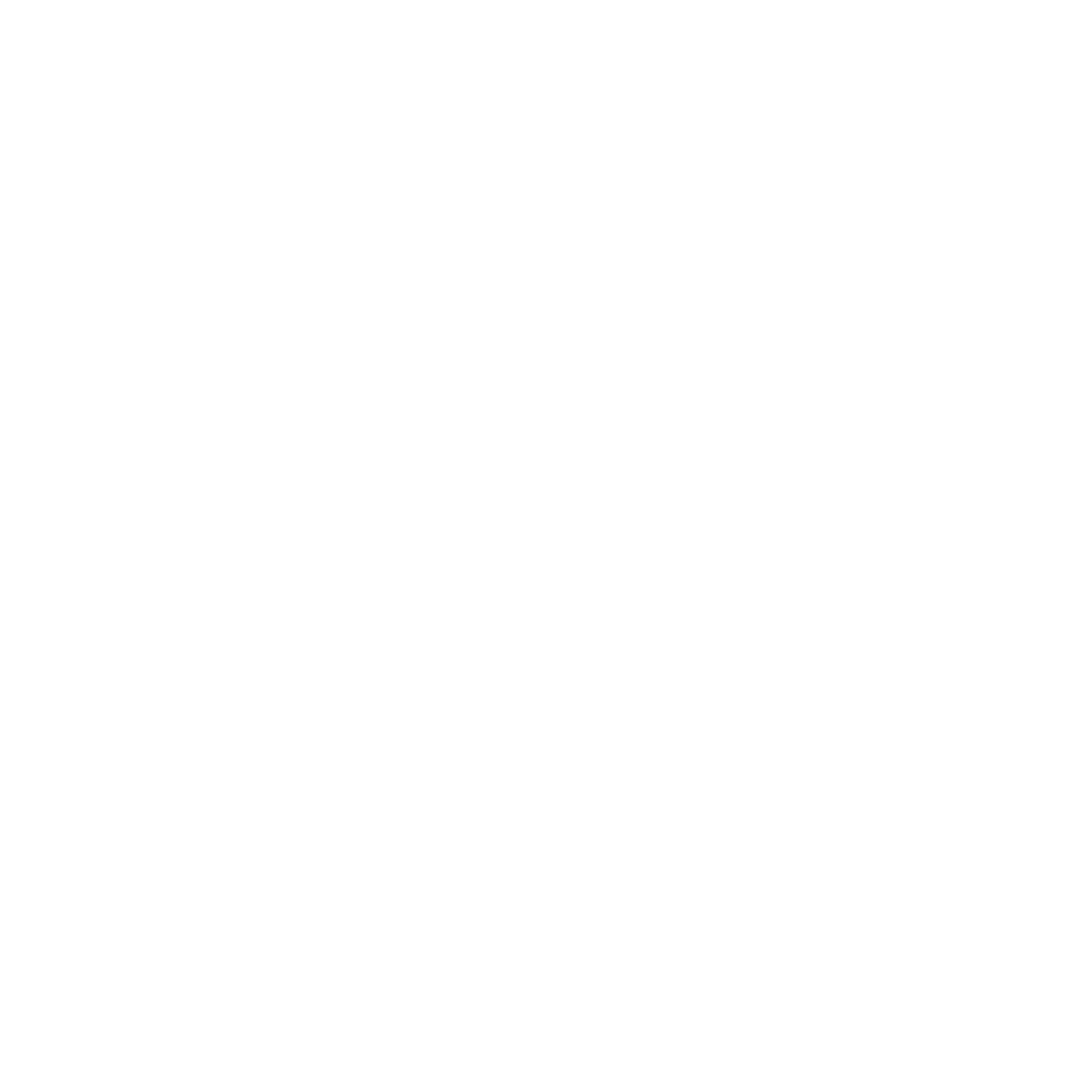Votre panier est actuellement vide !

Gérer son eau en randonnée : filtrage, quantité et ravitaillement
Que ce soit pour une balade à la journée ou un trek de plusieurs jours en autonomie, l’eau est l’élément vital du randonneur. Une bonne gestion de son eau en randonnée permet de partir l’esprit tranquille et d’éviter la déshydratation, sans pour autant porter un poids excessif. Comment déterminer la quantité d’eau à emporter ? Où trouver des points d’eau en chemin et comment s’y ravitailler ? Quelles techniques de filtration et de purification utiliser pour rendre l’eau potable ? Nous détaillons ici tous les conseils pratiques pour être autonome en eau lors de vos sorties en pleine nature. Vous trouverez également un focus sur le matériel de portage, notamment le sac à dos BaribalPro 60 L, un allié précieux pour transporter votre eau en randonnée.
Pourquoi l’eau est cruciale en randonnée
En randonnée, l’eau c’est la vie – c’est elle qui vous permet de vous hydrater, de cuisiner, voire de soigner de petites blessures ou simplement de vous rafraîchir. Notre corps perd de l’eau en permanence (transpiration, respiration…), et l’effort physique accélère cette perte. Marcher plusieurs heures avec un sac sur le dos, surtout par temps chaud ou en altitude, peut provoquer une déshydratation insidieuse. Une hydratation insuffisante entraîne fatigue, maux de tête, crampes et peut aller jusqu’au coup de chaleur en cas de forte chaleur. À l’inverse, rester bien hydraté aide à maintenir ses performances physiques et à mieux récupérer après l’effort.

Il est recommandé de boire avant d’avoir soif, par petites gorgées régulières tout au long de la marche. En effet, la sensation de soif est un signal tardif : lorsque vous avez soif, vous êtes déjà légèrement déshydraté. Prenez l’habitude de boire quelques gorgées toutes les 15-20 minutes environ, surtout par temps chaud. Pensez également à boire suffisamment avant de partir randonner (500 mL environ) pour commencer votre journée d’activité bien hydraté. L’hydratation doit être continue, même en ambiance froide ou nuageuse, car on peut se déshydrater même sans soleil brûlant. Enfin, soyez particulièrement vigilants avec les enfants qui se déshydratent plus vite que les adultes, et avec les seniors dont la sensation de soif est parfois moins prononcée. En résumé : buvez régulièrement, par petites quantités, et n’attendez pas la soif pour le faire. La gestion de l’eau en randonnée et en bivouac est important.
Combien d’eau faut-il emporter ?
La quantité d’eau à emporter dépend de plusieurs facteurs, mais une règle de base couramment admise est d’environ 2 à 3 litres d’eau par jour et par personne. Autrement dit, un randonneur moyen consomme autour de 2,5 L d’eau en 24 heures. Ce chiffre inclut principalement l’eau de boisson, mais n’oubliez pas que vos besoins peuvent augmenter selon les conditions et usages spécifiques :
- L’effort physique et le terrain : plus la randonnée est difficile (fort dénivelé, longue distance, portage lourd), plus la transpiration augmente, ce qui accroît vos besoins hydriques. Un sentier facile en sous-bois ne sollicitera pas autant votre corps qu’une ascension en plein soleil ; adaptez donc la quantité d’eau en conséquence.
- La météo : la chaleur est l’ennemi du randonneur mal hydraté. Par temps chaud ou en plein été, la consommation d’eau peut facilement doubler par rapport à la normale. Même par temps frais, ne sous-estimez pas vos besoins : on transpire aussi en hiver sous plusieurs couches de vêtements. Retenez que plus il fait chaud, plus il faut boire, mais que même sans canicule il est nécessaire de s’hydrater fréquemment.
- L’altitude : en montagne, l’air sec et l’effort en altitude augmentent la déperdition d’eau (respiration accélérée, diurèse accrue). Il est prudent de boire davantage en haute altitude. De plus, une astuce souvent mentionnée est que plus on monte, plus l’eau des ruisseaux est pure (car éloignée des sources de pollution humaines/animales), mais cela ne dispense pas de traiter l’eau (nous y reviendrons).
- Les besoins individuels : chaque personne a son propre métabolisme. Certains randonneurs boivent beaucoup, d’autres très peu. Apprenez à vous connaître : si vous savez que vous consommez d’habitude 3 L dans une journée estivale, ne prévoyez pas seulement 2 L ! Il vaut mieux emporter un peu plus que le strict minimum pour éviter la panne sèche.
- L’eau pour la cuisine et l’hygiène : si vous partez sur une journée complète ou en bivouac avec repas, prévoyez l’eau nécessaire pour cuisiner (réhydrater un plat lyophilisé demande ~0,3 L, cuire des pâtes peut consommer 1 L ou plus qu’on ne boira pas intégralement, etc.) et pour les boissons chaudes (café, thé) si vous en faites. Ajoutez aussi un peu d’eau pour l’hygiène de base : se brosser les dents, un brin de toilette le soir ou le matin, nettoyer une petite plaie… Cela peut représenter 0,5 L supplémentaire par jour selon les cas. Pensez-y dans votre calcul total. Avec ça vous partez avec assez d’eau en randonnée.
Astuce : si vous craignez de manquer, mieux vaut partir avec un peu d’eau en surplus en réserve. En cas de besoin, cette eau supplémentaire pourra faire la différence, par exemple si la randonnée dure plus que prévu ou si un point d’eau espéré est finalement à sec. Toutefois, l’eau étant lourde (1 kg par litre), il faut trouver un équilibre entre sécurité et poids à porter. C’est pourquoi une bonne planification des ravitaillements en eau permet souvent de ne pas tout porter d’un coup, comme nous allons le voir.
Planifier ses ravitaillements en eau en randonée
Porter 3 L d’eau ou plus dès le départ n’est pas toujours nécessaire : dans de nombreuses randonnées, on peut trouver de l’eau en chemin pour se ravitailler, à condition de bien préparer son itinéraire. Planifier ses points d’eau est un réflexe à adopter avant de partir :

- Étudier la carte et les guides : sur les cartes topographiques (par exemple les cartes IGN en France), sont indiqués les cours d’eau (rivières, ruisseaux), les sources, les lacs, ainsi que des symboles pour les fontaines ou points d’eau. Repérez sur votre tracé les points d’eau possibles. Les guides de randonnée ou topo-guides mentionnent souvent les sources ou refuges où l’on peut se ravitailler. Vous pouvez aussi consulter les forums de randonneurs pour glaner des infos à jour sur tel ou tel point d’eau (certains sources peuvent être saisonnières).
- Utiliser les applications et sites web : il existe des applications collaboratives qui recensent les points d’eau potable, comme Owater, WeTap ou les données intégrées dans certaines apps de randonnée (Komoot, Visorando, etc.). Ces outils peuvent vous indiquer qu’au village du bout de la vallée il y a une fontaine, ou qu’à tel refuge on trouve un robinet.
- Identifier les sources naturelles d’eau : sur le terrain, sachez reconnaître les opportunités. Les rivières et torrents offrent de l’eau courante ; préférez-les aux eaux stagnantes (mares, flaques) plus susceptibles d’être contaminées. Les sources (eau qui jaillit du sol) sont en général plus fiables car filtrées naturellement par le substrat, mais elles peuvent être difficiles à trouver sans indication. Les lacs et étangs sont des réserves d’eau tentantes mais souvent stagnantes : utilisez-les en dernier recours ou assurez-vous de bien traiter l’eau. En montagne, l’eau des torrents de haute altitude est généralement plus pure qu’en plaine, car il y a moins de pollution ; toutefois une eau cristalline peut quand même renfermer des microbes invisibles.
- Les points d’eau « artificiels » : en zone habitée ou fréquentée, profitez des infrastructures humaines. Par exemple, les fontaines publiques dans les villages (attention, elles ne sont pas toutes potables : c’est souvent indiqué, sinon renseignez-vous) ou les robinets de cimetière (souvent disponibles en France, avec une eau courante parfois non potable mais filtrable) sont des bons plans pour remplir vos bouteilles. Sur les itinéraires populaires, il y a parfois des abreuvoirs pour le bétail ou des cabanes/refuges non gardés avec un collecteur d’eau de pluie. Enfin, n’hésitez pas à demander de l’eau aux habitants si vous passez près de fermes ou de maisons isolées : la plupart des gens seront généreux pour remplir une gourde, surtout pour un randonneur poli (et vous pourriez faire de belles rencontres locales). Comme le dit l’humour de certains randonneurs, n’hésitez pas à frapper chez Michel et Yvette qui le feront de bon cœur !
En résumé, plus il y a de points d’eau fiables sur votre parcours, moins vous avez besoin de porter d’eau dès le départ. Si vous savez qu’en milieu de journée vous traverserez un village avec fontaine ou un torrent, vous pouvez partir avec une quantité moindre et remplir en chemin. Par exemple, sur un sentier avec plusieurs sources, emporter 1 à 1,5 L peut suffire puis on remplit régulièrement. À l’inverse, sur un parcours sec sans aucune source, il faudra porter toute l’eau nécessaire pour la journée (voire plus), ce qui peut signifier 3, 4, 5 L ou plus selon la durée et la température – un vrai défi, mais parfois indispensable. Certaines régions (plateaux karstiques, zones arides, haute montagne) sont très pauvres en eau, renseignez-vous bien à l’avance. Dans ces cas-là, envisagez de cacher de l’eau à l’avance (dépôt d’eau sur le parcours la veille, si logistique possible) ou de placer votre itinéraire de façon à passer à un point de ravitaillement intermédiaire (par exemple, faire un détour par un refuge gardé où l’on peut acheter de l’eau ou du thé). Il est donc important de repérer avant votre départ en randonnée les différents point d’eau.
Conseil : en début de randonnée, buvez abondamment aux sources ou points d’eau rencontrés, même si vous n’avez pas très soif sur le moment. Profitez-en pour faire le plein au maximum de vos contenants à chaque source clé, puis continuez la route. Ainsi, vous resterez hydraté sans avoir à transporter inutilement des litres en trop entre deux sources.
Quels contenants pour transporter l’eau ?
Avoir de l’eau c’est bien, pouvoir la transporter facilement c’est mieux. Le choix des contenants (bouteilles, poches…) et leur répartition dans le sac à dos impacte votre confort et votre efficacité d’hydratation. Voici les principales options de contenants, avec leurs avantages et inconvénients :
- Gourde métallique : La gourde traditionnelle en aluminium ou en acier inoxydable est robuste et durable. Elle résiste aux chocs et conserve bien la fraîcheur au besoin. En revanche, elle est lourde à vide, et peut donner un léger goût métallique à l’eau selon le matériau ou si l’eau stagne longtemps dedans. En hiver, attention : le métal conduit le froid, l’eau peut y geler plus vite, à moins d’avoir un modèle isotherme ou de la protéger (et gare aux doigts qui collent sur une gourde très froide).
- Gourde en plastique (type Nalgene ou équivalent) : Légère et incassable, c’est un choix populaire. Les modèles de qualité ne donnent pas de goût à l’eau. Certains modèles modernes intègrent même un filtre à eau dans le bouchon, ce qui permet de remplir directement dans une rivière et de boire filtré – pratique en complément d’une autre gourde. L’inconvénient principal est la contenance limitée : la plupart font 1 L, parfois 1,5 L, donc il en faut plusieurs pour de gros besoins (ceci dit, on peut compléter par d’autres contenants flexibles).
- Bouteille d’eau en plastique (type bouteille minérale du commerce) : Solution peu coûteuse et très légère. Une bouteille d’1,5 L du commerce pèse à peine quelques grammes une fois vide, ne donne pas de goût, et peut se squeezer (compresser) un peu une fois vide. Beaucoup de randonneurs utilisent simplement des bouteilles recyclées. Le gros défaut est écologique : ce n’est pas la solution la plus durable ni la plus respectueuse de l’environnement, surtout si on les jette ensuite. On peut toutefois réutiliser plusieurs fois la même bouteille en plastique pour limiter l’impact.
- Poche à eau (réservoir d’hydratation) : C’est une poche souple en plastique alimentaire, de 1,5 L à 3 L généralement, équipée d’un tuyau avec embout que l’on fixe près de l’épaule. La poche se range dans le sac à dos, dans un compartiment prévu ou contre le dos, et permet de boire en continu sans s’arrêter, en aspirant via le tuyau. Cette solution est très appréciée pour s’hydrater régulièrement sans contrainte. Elle est également légère et se plie quand vide. En revanche, ses inconvénients sont à noter : on ne voit pas facilement la quantité restante (risque de tomber à sec sans prévenir), le tuyau peut geler en hiver ou se boucher, et certaines poches donnent un goût plastique à l’eau (choisissez des marques de qualité pour éviter le goût, et nettoyez bien avant la première utilisation). Aussi, le remplissage d’une poche à eau peut être un peu fastidieux selon les modèles : préférez ceux à large ouverture.

- Bouteille filtrante ou gourde avec filtre intégré : Ce sont des bouteilles (souvent en plastique sans BPA) dotées d’une cartouche filtrante intégrée. On peut ainsi puiser de l’eau dans une rivière ou un lac avec la gourde, et l’eau est filtrée en buvant ou en la versant. C’est un système 2-en-1 intéressant pour épurer l’eau en marchant, mais le débit est parfois limité et la capacité de la gourde est modeste (0,5 à 0,75 L en général). Il en existe de différentes marques (LifeStraw, Grayl, Katadyn BeFree, etc.) avec divers niveaux de filtration.
- Contenants pliables d’appoint : Pour les treks en autonomie ou le campement, il existe des poches souples supplémentaires (type Water pouch de 4 ou 6 L, jerrycan souple) ou même des bouteilles ultralégères format flasque de 500 mL à 1 L qu’on peut plier une fois vides. Ces contenants d’appoint sont utiles pour stocker plus d’eau au bivouac ou sur un tronçon sec. On les remplit quand nécessaire puis on les range une fois vides sans qu’ils prennent de place. Bien sûr, ajouter 5 L d’eau dans un jerrycan souple alourdira fortement votre sac (5 kg de plus), donc réservez-les pour quand c’est nécessaire (par exemple porter de l’eau pour la nuit de bivouac si la tente est loin de la source, ou traversée d’une zone sans eau).
Conseil : souvent combiner plusieurs contenants est la clé. Par exemple, vous pouvez partir avec une gourde d’accès rapide (sur le côté du sac ou à la bretelle) + une poche à eau de 2 L dans le sac pour boire en marchant + une bouteille vide en réserve que vous remplirez si besoin pour augmenter la capacité. Ou encore, deux bouteilles d’1 L réparties dans les poches latérales du sac pour équilibrer le poids, plus un petit récipient souple pour filtrer de l’eau au bivouac. Ayez aussi au minimum deux contenants séparés : cela permet si l’un se perce ou se perd, de ne pas être sans rien. De plus, lors du traitement de l’eau par filtration ou désinfection, il est pratique d’avoir un récipient « en cours de purification » et un autre avec de l’eau prête à boire.
Filtrer et purifier l’eau recueillie
Trouver de l’eau, c’est bien, mais encore faut-il qu’elle soit potable. À moins de remplir directement au robinet chez l’habitant ou à une source sûre, l’eau prélevée dans la nature contient potentiellement des micro-organismes (bactéries, virus, protozoaires comme les amibes et Giardia) et parfois des polluants chimiques (pesticides, nitrates…). Boire de l’eau contaminée peut causer de sérieux problèmes digestifs (diarrhées, crampes) et gâcher votre randonnée en quelques heures. Il est donc impératif de traiter l’eau pour la rendre potable, sauf certitude absolue de sa qualité. Voici les principales méthodes de traitement de l’eau en randonnée :
1. Les filtres à eau
Les filtres de randonnée (filtres compacts, pailles filtrantes type LifeStraw, systèmes à pompe ou à gravité) utilisent une membrane micro-poreuse pour éliminer les bactéries, les parasites (protozoaires) et les sédiments de l’eau. L’eau est ainsi clarifiée et la majorité des germes pathogènes sont retenus par le filtre. Certains modèles se fixent sur une gourde ou une poche à eau, d’autres s’utilisent comme une paille directement à la source, ou encore comme une pompe entre le cours d’eau et votre gourde. Avantages : permet d’obtenir rapidement une eau claire et buvable sans goût désagréable, et on peut traiter de grandes quantités (plusieurs centaines à milliers de litres sur la durée de vie du filtre). Limite : un filtre standard n’élimine pas les virus, dont la taille microscopique passe à travers les pores. En Europe, le risque viral (hépatite A/E, rotavirus…) dans les eaux sauvages est faible mais pas nul. En zone tropicale ou agricole, il peut y avoir plus de virus et de polluants chimiques. Pour une protection complète, il faut alors combiner avec un traitement chimique ou UV en plus du filtre. Par ailleurs, un filtre n’agit pas sur d’éventuels produits chimiques dissous (sauf s’il intègre du charbon actif qui réduit un peu pesticides, métaux lourds, mauvais goût). En résumé : le filtre seul est idéal pour rendre une eau claire et sûre biologiquement à 99%, mais en cas de doute sur les virus, combinez-le à un autre traitement. N’oubliez pas d’entretenir votre filtre (nettoyage, séchage) selon les recommandations, pour éviter qu’il ne colmate ou ne développe des moisissures entre deux randos.
2. Les désinfectants chimiques (pastilles ou gouttes)
C’est la méthode la plus légère et simple : il s’agit de pastilles purificatrices (marques Micropur, Aquatabs, etc.) à base de chlore, de dioxyde de chlore ou d’iode, ou bien de gouttes désinfectantes à ajouter dans l’eau. Ces traitements chimiques détruisent les bactéries, virus et la plupart des parasites. On les utilise en déposant la pastille ou quelques gouttes dans la gourde remplie d’eau clair (si l’eau est trouble, il vaut mieux la pré-filtrer grossièrement à travers un tissu par exemple). Avantages : très léger à transporter, facile à utiliser, élimine y compris les virus (atout par rapport aux filtres). Inconvénients : il faut attendre que le produit agisse – généralement 30 minutes à 2 heures de contact selon les produits – avant de boire l’eau. L’eau traitée a souvent un léger goût de chlore ou d’iode peu agréable. De plus, certains parasites comme le Cryptosporidium résistent au traitement chimique standard (d’où l’intérêt de combiner avec un filtrage si on suspecte ce genre de menace, par exemple sur eaux vraiment stagnantes). Enfin, ces produits chimiques finissent dans votre organisme et dans la nature, ce n’est pas dramatique aux doses utilisées mais ce n’est pas 100% écologique non plus. En résumé : les pastilles ou gouttes sont une excellente solution d’appoint ou de secours, à avoir dans son sac au cas où, ou pour compléter un filtrage, mais le délai d’attente et le goût sont leurs principaux défauts.

3. L’ébullition de l’eau
Faire bouillir de l’eau est la méthode de purification la plus ancienne et l’une des plus efficaces. Porter l’eau à ébullition franche pendant 1 minute (ou 3 minutes au-dessus de 2000 m d’altitude) élimine tous les organismes pathogènes : bactéries, virus. C’est donc un traitement fiable à 99,9%. Avantages : efficacité incomparable, et convient même à l’eau très trouble (bien qu’il faille la filtrer après coup pour enlever les débris). Pas de souci de goût de chlore ou autre. Inconvénients : cela suppose que vous transportiez un réchaud et du combustible (gaz, alcool, bois…) pour faire chauffer l’eau, ainsi qu’un contenant métallique (popote) pour la faire bouillir. Faire bouillir consomme du carburant et prend du temps, surtout si vous devez traiter plusieurs litres. Il faut aussi laisser refroidir avant de boire, ce qui prend du temps. Cette méthode est donc surtout utilisée au camp (bivouac le soir) plus qu’en pleine journée de marche. On peut par exemple le faire le soir pour avoir de l’eau stérile le lendemain (penser à bien la couvrir pendant la nuit). En résumé : l’ébullition est très sûre mais peu pratique en mouvement. En randonnée légère à la journée, ce n’est pas très adapté, mais en trek avec bivouac ça peut compléter les autres méthodes. Parfait pour toujours avoir de l’eau en randonnée.
4. Les systèmes à ultraviolets (UV)
La stérilisation par rayons UV est une technique relativement moderne dans le monde de la rando. Des petits appareils (comme le SteriPEN, ressemblant à un gros stylo) émettent des UV-C qui détruisent les micro-organismes dans l’eau. Il suffit de plonger la lampe UV dans une gourde d’eau claire et de l’allumer pendant le temps indiqué (environ 1 à 3 minutes selon le volume), puis l’eau est . Avantages : élimine bactéries, virus et parasites sans additif chimique, sans altérer le goût de l’eau. C’est rapide et assez simple d’utilisation. Inconvénients : l’appareil nécessite des piles ou une batterie, il peut tomber en panne ou s’avérer inefficace si l’eau est trop trouble (les UV sont bloqués par les sédiments). Il faut donc filtrer grossièrement l’eau avant UV si elle n’est pas limpide. De plus, ces appareils restent coûteux et ajoutent un peu de poids dans le sac. Ils sont néanmoins une option intéressante pour ceux qui partent souvent et veulent un système efficace contre les virus sans recourir aux produits chimiques.
5. Combiner les méthodes si nécessaire
Aucune méthode n’étant parfaite à 100%, pensez qu’il est parfois utile de combiner deux méthodes pour une eau vraiment douteuse. Par exemple, filtrer puis utiliser une pastille de chlore assure une double protection (le filtre enlève les impuretés et la plupart des microbes, la pastille tue les virus éventuels). Filtrer puis faire bouillir est aussi très sûr (l’ébullition achevant le travail du filtre) et permet d’avoir une eau neutre en goût. Ces solutions combinées sont surtout à envisager dans des zones à risque (eaux vraiment sales, pays où sévissent des virus dans l’eau, sources en aval de zones polluées, etc.). La majorité du temps en randonnée, un seul système bien utilisé suffit. Par exemple, en France sur un torrent d’altitude clair, un filtre ou des pastilles seuls font généralement l’affaire. Mais en cas de doute sérieux, ne prenez pas de risque : mieux vaut perdre 30 minutes à traiter en double que d’être malade pendant trois jours. la gestion de l’eau est essentiel pour faire des randonnée.
Bonnes pratiques de prélèvement : Peu importe la méthode de purification choisie, essayez de prélever l’eau de la meilleure qualité possible à la base. Idéalement, puisez l’eau là où le courant est vif (eau plus oxygénée et moins stagnante) et en amont de toute zone de pâturage ou de camping afin d’éviter les pollutions par les hommes ou les animaux. Évitez les points d’eau juste en aval d’un troupeau ou d’un refuge mal équipé en sanitaires… Si l’eau est trouble, filtrer d’abord grossièrement avec un tissu ou un bandana permet de retirer le sable, les débris, feuilles, etc. Pensez également à nettoyer vos contenants : une gourde mal lavée peut contaminer une eau pourtant pure au départ.
Optimiser son hydratation tout au long de la randonnée
Au-delà de la quantité d’eau et de la purifier, il convient d’adopter de bonnes pratiques pour rester hydraté sans porter inutilement 10 L d’eau. Voici quelques conseils pratiques pour bien gérer votre hydratation sur le terrain :
- Hydratez-vous avant l’effort : Comme mentionné plus haut, buvez 0,5 L (500 mL) d’eau environ avant de démarrer la randonnée. Cela vous évitera de puiser trop vite dans vos réserves durant la première heure de marche.
- Buvez par petites gorgées fréquentes : Prendre quelques gorgées toutes les 15-20 minutes est plus efficace que de boire un demi-litre d’un coup toutes les 3 heures. Les petites quantités fréquentes optimisent l’absorption de l’eau par le corps et évitent la sensation de gargouillis ou les pics/srels de soif.

- Rendez l’eau facilement accessible : Si sortir la bouteille du sac vous décourage de boire, vous allez vous priver inconsciemment. Placez votre gourde à portée de main (poche latérale du sac, fixé sur la bretelle, etc.), ou utilisez une poche à eau avec tuyau pour pouvoir boire en marchant. Le sac à dos que vous utilisez peut aider : par exemple, un modèle doté de poches latérales en mesh ou de fixations sur les bretelles pour les flasques rend l’hydratation plus pratique.
- Pensez aux électrolytes : En transpirant, on perd non seulement de l’eau mais aussi des sels minéraux (sodium, potassium, etc.). Sur des randonnées longues ou par forte chaleur, boire uniquement de l’eau peut ne pas suffire à bien réhydrater l’organisme. Emportez de petites doses d’électrolytes (comprimés effervescents à dissoudre, poudres isotoniques, ou simplement une pincée de sel et quelques fruits secs). Cela permet de compenser les pertes en minéraux et d’éviter les coups de fatigue ou les crampes liés à un déséquilibre électrolytique.
- Adaptez votre alimentation : Consommer des fruits riches en eau (orange, pomme) ou des aliments salés (noix salées, saucisson) peut aider à la fois à hydrater et à apporter du sel. À l’inverse, évitez les boissons très sucrées ou caféinées pendant la marche : elles peuvent déshydrater davantage ou causer des pics d’énergie suivis de coups de barre. Gardez les sodas et bières pour la célébration après la rando 😉.
- Protégez-vous de la chaleur : Moins vous subissez le soleil ou le chaud, moins vous transpirez. Portez un chapeau, des vêtements légers à manches longues, marchez à l’ombre quand c’est possible. Faire une pause à l’ombre durant les heures les plus chaudes permet de réduire la sudation. En réduisant ces pertes, on économise aussi l’eau du bidon.
- En cas de froid : N’oubliez pas de boire par temps froid également. Une astuce pour allier hydratation et réconfort est de transporter une boisson chaude dans un thermos (thé, infusion) ou de prévoir une soupe déshydratée le midi. Cela vous incitera à boire et vous réchauffera en même temps. Évitez de boire de l’alcool en rando : cela donne une fausse impression de chaleur mais déshydrate et diminue la vigilance.
- Anticipez les besoins au bivouac : Si vous campez en autonomie, pensez à arriver à votre lieu de bivouac avec suffisamment d’eau pour la soirée et la nuit, surtout s’il n’y a pas de source à proximité. En général, arrivez avec de quoi préparer le repas du soir, le petit-déjeuner du lendemain et rester hydraté entre-temps. Cela peut vouloir dire remplir tous vos récipients à la dernière source avant le bivouac. Si vous bivouaquez près d’un lac ou d’une rivière, c’est parfait (mais n’oubliez pas de traiter l’eau). Dans le cas contraire, chargez-vous en eau sur les derniers kilomètres, même si c’est lourd sur la fin, pour être tranquille une fois le camp installé.
- Situations extrêmes : Quelques rappels évidents en survie : ne buvez jamais d’eau de mer, même diluée – c’est fortement déshydratant. Ne mangez pas la neige non fondue pour vous hydrater : cela refroidit le corps et peut provoquer des troubles digestifs. Faites-la toujours fondre (au soleil ou au réchaud) avant de la boire. Enfin, si vous êtes vraiment en détresse sans eau potable, des solutions de survie existent (distillation solaire, boire de l’eau croupie après triple traitement, etc.), mais idéalement une bonne planification évite d’en arriver là.
Le sac à dos : un allié pour porter et accéder à l’eau en randonnée
Le choix de votre sac à dos de randonnée joue un rôle dans la gestion de l’eau, car il permet de transporter vos réserves et d’y accéder facilement. Un sac bien conçu vous aidera à porter le poids de l’eau de manière optimale et à boire sans effort. Par exemple, le sac à dos BaribalPro 60 L est un modèle de grande capacité qui présente plusieurs atouts utiles pour l’hydratation en randonnée :

- Grande capacité de portage : Avec 60 litres de volume, ce sac offre amplement de place pour emporter tout le matériel de trek et plusieurs litres d’eau. Cela le rend idéal pour les sorties en autonomie où l’eau peut représenter une part significative du poids à transporter (trek dans le désert, bivouac sans sources, etc.). La charge est bien répartie grâce à son système de portage confortable, ce qui aide à supporter le poids de l’eau sans douleur.
- Compatibilité avec poche à eau : Ce sac intègre un système d’hydratation intégré, c’est-à-dire un compartiment interne spécialement prévu pour accueillir une poche à eau, avec une ouverture pour faire passer le tuyau jusqu’aux bretelles. Vous pouvez ainsi installer votre réservoir d’eau (2 L par exemple) à l’intérieur du sac et garder le tube à portée de bouche. Boire en marchant devient très facile – pas besoin d’enlever le sac pour attraper sa gourde, ce qui encourage à s’hydrater régulièrement.
- Poches et accès pratiques : Le BaribalPro 60 L, comme d’autres sacs de sa catégorie, possède des poches latérales où l’on peut glisser des bouteilles d’eau de 1 L à 1,5 L. Ces poches filet ou zippées permettent d’attraper rapidement une gourde sans ouvrir le sac. De plus, on peut utiliser les sangles de compression pour fixer des bouteilles supplémentaires si nécessaire. Avoir plusieurs poches externes vous aide à séparer les contenants (par ex., bouteille d’eau propre vs. bouteille en cours de traitement).
- Confort et ventilation : Porter 3 ou 4 kg d’eau dans un sac peut mettre le dos à rude épreuve. Un bon sac de 60 L doté de bretelles rembourrées en forme ergonomique, d’une ceinture ventrale solide et d’un dos aéré sera un vrai plus. Le modèle BaribalPro offre un dos ventilé et ajustable pour épouser votre morphologie et laisser l’air circuler. Cela réduit la transpiration dorsale (et donc la perte d’eau !) et assure un confort sur la durée, même avec une charge conséquente.
- Résistance et protection : Enfin, un sac robuste et déperlant comme celui-ci protège votre équipement et vos réserves d’eau des intempéries. Son tissu résistant évite les déchirures : vous pouvez poser le sac au sol même chargé d’eau sans craindre qu’il ne se perce. C’est un détail, mais une fuite d’eau dans le sac peut être catastrophique (non seulement vous perdez de l’eau, mais en plus vos affaires sont trempées). Un sac qualitatif limite ce risque grâce à des matériaux solides et souvent un traitement déperlant.
En somme, bien s’équiper d’un sac à dos adapté facilite grandement la gestion de l’eau. Privilégiez un sac qui correspond à votre usage : pour de longues randos en autonomie, 50 à 70 L permettent de tout porter (eau, nourriture, tente…). Vérifiez la présence d’une compatibilité poche à eau, ou au minimum de poches extérieures pour bouteilles. N’hésitez pas à tester le sac chargé avec le poids d’eau prévu avant une grande aventure, afin d’ajuster les réglages de portage et d’éviter les mauvaises surprises sur le terrain.
Conclusion
Gérer son eau en randonnée demande un peu d’anticipation et de savoir-faire, mais c’est la clé pour randonner en sécurité et avec plaisir. Retenez qu’un randonneur boit en moyenne 2 à 3 L d’eau par jour, davantage en conditions difficiles. Il faut donc prévoir la bonne quantité d’eau au départ, et tirer parti des points d’eau sur votre itinéraire pour vous ravitailler dès que possible. Traitez toujours l’eau recueillie (filtration, purification chimique, ébullition ou UV) pour éviter les problèmes de santé – ne prenez aucun risque avec l’eau douteuse, votre estomac vous dira merci. Adoptez de bonnes habitudes d’hydratation régulière et équipez-vous de contenants adaptés, en combinant gourdes, poches à eau, etc., pour un accès facile et un portage équilibré. Enfin, un sac à dos approprié comme le BaribalPro 60 L vous apportera le confort et les fonctionnalités nécessaires pour transporter vos litres d’eau sans encombre.
En suivant ces conseils, vous serez capable de partir en randonnée en toute autonomie en eau, que ce soit pour une journée ou un trek de plusieurs semaines. Vous éviterez ainsi le stress de la panne d’eau et profiterez pleinement de votre aventure en pleine nature. Bonne randonnée et n’oubliez pas de boire régulièrement !